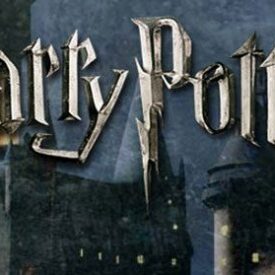Qu’est-ce qui a fait de la naginata un symbole de lutte, de défense et de fierté ? Imaginez le craquement de la forêt sous les sabots, le nuage de poussière après une charge de cavalerie et, au centre, la figure qui domine l’espace avec une lame courbe au bout d’un manche : c’est la naginata. Dans cet article, vous découvrirez son origine, sa transformation sociale, les techniques qui l’ont rendue légendaire et comment elle est devenue un art martial moderne pratiqué dans le monde entier.

Je vous expliquerai l’anatomie de l’arme, son utilisation tactique au combat, sa relation avec les onna-bugeisha (les femmes guerrières samouraïs), l’évolution institutionnelle du naginatajutsu jusqu’à l’Atarashii Naginata contemporain et ce que signifie sa pratique aujourd’hui. De plus, vous trouverez des chronologies, des tableaux comparatifs et des ressources pour identifier les répliques et les modèles historiques.
Naginata : évolution historique de l’arme d’hast à l’art martial moderne
Avant d’entrer dans les détails techniques, il convient de situer la naginata dans une ligne temporelle qui montre son parcours du champ de bataille aux dōjōs contemporains. La chronologie clarifie pourquoi l’arme a muté d’outil militaire à symbole culturel et discipline sportive.
| Époque | Événement |
|---|---|
| Période Nara (710-794 ap. J.-C.) | |
| Origine débattue | La naginata a pu être introduite au Japon par des échanges avec la Chine (Dynastie Song) et des moines bouddhistes ; elle a peut-être évolué à partir du tehoko. Elle est devenue une arme importante des moines guerriers (sōhei). |
| Xe siècle | |
| Utilisation par les moines guerriers | Début documenté de l’utilisation habituelle de la naginata par les moines guerriers (sōhei). |
| Période Heian (794-1185 ap. J.-C.) | |
| Utilisation militaire et caractéristiques | Utilisée par l’infanterie pour se défendre de la cavalerie ; lames courbes de 30–60 cm et manches de 120–240 cm. Entraînement au naginatajutsu parmi les guerriers, y compris les femmes. |
| Guerre de Genpei (1180-1185 ap. J.-C.) | |
| Ascension et renommée | La naginata gagne en popularité auprès des clans Minamoto et Taira pour son efficacité contre la cavalerie ; elle apparaît dans l’œuvre classique Le Dit des Heike. L’armure s’adapte (introduction des suneate) pour protéger contre les coups bas. |
| Période Kamakura (1185-1333 ap. J.-C.) | |
| Continuité | La naginata reste une arme populaire parmi les guerriers masculins. |
| Période Nanbokuchō (1331-1392 ap. J.-C.) | |
| Arme préférée | Dans un contexte de conflits constants, la naginata, polyvalente pour l’estoc et la coupe, est préférée par les samouraïs aux lances plus courtes de l’époque. |
| Guerre d’Ōnin (1467-1477 ap. J.-C.) | |
| Déclin sur le champ de bataille | Les tactiques d’infanterie de masse et l’apparition de lances beaucoup plus longues (yari) réduisent l’utilité de la naginata au combat ; cependant, elle continue d’être pratiquée comme art martial civil. |
| Période Sengoku (c. 1467-1615 ap. J.-C.) | |
| Transition vers l’usage féminin | Avec une utilisation militaire moindre, le naginatajutsu devient une arme de défense pour les dames des familles samouraïs pendant cette période turbulente. |
| Période Edo (1603-1868 ap. J.-C.) | |
| Relégation et symbolisme | Pendant la paix Tokugawa, la naginata quitte le combat de masse et devient honorifique. La ko-naginata (plus maniable) est utilisée comme arme d’autodéfense et symbole social ; elle était fréquente dans la dot féminine. Le shogunat interdit les grandes armes, mais permet la continuité de l’art ; des dojos apparaissent et la représentation dans les ukiyo-e popularise l’image des onna-bugeisha. |
| Années 1890 | |
| Revalorisation et organisation | Renaissance de l’intérêt pour les arts martiaux avec la croissance du sentiment national japonais. Fondation de la Dai Nihon Butokukai (1895). |
| Division de naginata | La Dai Nihon Butokukai crée en 1904 une division spécifique dédiée à la naginata. |
| Années 1900 — 1936 | |
| Éducation féminine | Le naginatajutsu est introduit dans les collèges et universités pour femmes. En 1913, les écoles moyennes et supérieures peuvent choisir la naginata comme matière régulière ; en 1936, elle devient une matière obligatoire pour les femmes. |
| Fin de la Seconde Guerre Mondiale (1945) et après-guerre | |
| Interdiction et réinvention | Les forces alliées interdisent les arts martiaux. Par la suite, un comité est formé qui développe un nouveau système, initialement appelé gakko naginata (naginata scolaire) et rebaptisé Atarashii Naginata (nouvelle naginata) pour le différencier du naginatajutsu traditionnel. |
| Années 1950 | |
| Fédération nationale | En 1955, la Fédération Japonaise de Naginata (AJNF) est fondée pour superviser le développement de la naginata moderne. |
| Réintroduction dans les écoles | En 1959, le gouvernement accepte la proposition d’Atarashii Naginata et autorise son enseignement dans les écoles supérieures. |
| 1990 | |
| Internationalisation | La Fédération Internationale de Naginata (INF) est créée face à la pratique internationale croissante de l’art. |
| Actualité | |
| État actuel | La naginata est aujourd’hui un gendai budō de caractère sportif pratiqué par les deux sexes. Son rôle dans le développement personnel et la paix est souligné. Les principales compétitions sont l’engi (katas) et le shiai (combat avec armure et points) ; les Championnats du Monde sont organisés tous les quatre ans. La pratique s’est répandue mondialement, y compris dans des pays d’Amérique Latine comme le Brésil, l’Argentine, le Chili, le Mexique et l’Uruguay. |
- Période Nara (710-794 ap. J.-C.)
-
- Origine : Influence chinoise possible et utilisation par les moines sōhei.
- Période Heian — Xe siècle
-
- Utilisation : Infanterie et défense contre la cavalerie ; lame de 30–60 cm ; manche de 120–240 cm.
Conception et anatomie : comprendre le mélange entre épée et lance
La naginata combine des éléments d’épée et de lance. Ce n’est pas une lance ordinaire, ni une simple prolongation d’un katana : sa lame courbe attachée à un long manche crée un outil de combat avec un large répertoire technique. Connaître son anatomie aide à comprendre pourquoi elle était si efficace entre des mains expérimentées.
Parties essentielles
- Ha (lame) : Courbe, entre 30 et 60 cm habituellement ; conçue pour les coupes longues et les estocs ponctuels.
- Ura et omote : Faces de la lame qui déterminent l’orientation de la coupe.
- Mune : Dos de la lame ; sur certaines naginata historiques, il est notablement renforcé.
- Nakago : Soie qui s’insère dans le manche et est fixée avec des chevilles ou des nœuds.
- Bo (manche) : Traditionnellement construit en bois de chêne ; longueur entre 120 et 240 cm selon la variante et l’utilisation.
- Tsuba ou sections de préhension : Comprend parfois des renforts pour la préhension ; sur les modèles modernes, il existe de petites gardes ou des gardes adaptées.
La combinaison du poids en pointe et de la longueur du manche crée un grand moment d’inertie. Cela permet des balayages dévastateurs et aussi des changements rapides de direction si le guerrier maîtrise le balancement et le centre de gravité.
Tactiques sur le champ de bataille
Dans les plaines médiévales, la naginata était utilisée à la fois pour contrôler le terrain et pour neutraliser la cavalerie. Ses techniques appliquaient la physique : des balayages qui atteignaient les chevilles et les montures, des estocs entre les armures et des coupes qui exploitaient la vitesse angulaire de la lame. La naginata pouvait faire partie de lignes défensives ou d’unités mobiles d’infanterie légère.
- Contre la cavalerie : Balayages aux pattes du cheval ou du cavalier pour déstabiliser la charge.
- Formations défensives : Position en demi-cercle ou en ligne pour créer une barrière de lames qui arrêtait l’avancée ennemie.
- Combat individuel : Utilisation de pas courts, de pivots et de contrôle de la portée pour chercher des coups sur des zones non protégées.
Variantes tactiques
L’existence de l’ō-naginata (plus longue et plus lourde) et de la ko-naginata (plus courte et plus agile) répond à des besoins tactiques. La première mettait l’accent sur le coup massif en formations ; la seconde facilitait le combat dans des espaces réduits ou la défense personnelle dans des environnements domestiques.
De l’arme militaire au symbole féminin : les onna-bugeisha
La transition de la naginata vers le domaine féminin est l’une des histoires les plus puissantes de son héritage. En temps de paix, les femmes des familles samouraïs ont maintenu les techniques comme moyen de défense du foyer. L’arme s’est adaptée : la ko-naginata était plus légère, plus maniable et plus adaptée aux espaces domestiques.
Des personnages comme Tomoe Gozen ont alimenté l’image épique de la guerrière avec naginata, bien que de nombreux récits mélangent mythe et réalité. Ce qui est pertinent, c’est que la pratique du naginatajutsu par les femmes a consolidé un rôle social : la naginata a cessé d’être seulement un outil de guerre pour devenir un emblème de statut, de discipline et de préparation.
Institutionnalisation et renaissance : du Meiji à l’Atarashii Naginata
La restauration Meiji et l’occidentalisation ont entraîné le déclin de nombreux arts martiaux. Cependant, la réaction nationaliste à la fin du XIXe siècle a stimulé la récupération des traditions. La fondation de la Dai Nihon Butokukai et la création d’une division spécifique pour la naginata en 1904 ont marqué le début de son institutionnalisation moderne.
Après la Seconde Guerre Mondiale, l’Atarashii Naginata a été développé, une version adaptée à la pratique scolaire et sportive qui a préservé la technique essentielle mais l’a réglementée pour la sécurité et la pédagogie. Aujourd’hui, cette modalité est régie par des fédérations qui organisent des compétitions internationales et promeuvent l’enseignement mixte par genre et âge.
Équipement, sécurité et règles modernes
En Atarashii Naginata, on utilise un équipement de protection inspiré du kendo mais adapté : men (protection de la tête), do (torse), tare (taille et bassin), kote (gantelets) et, dans de nombreuses écoles, suneate (protège-tibias) en raison de la nature des attaques dirigées vers les jambes. Les naginata de pratique sont fabriquées en bambou ou en matériaux synthétiques modernes pour minimiser les risques.
Modalités de compétition
- Engi : Katas préétablis évalués sur la précision, le rythme et la forme.
- Shiai : Combat direct avec armure où les coups valides sur des zones spécifiques sont marqués.
Types de naginata et comment elles se différencient
Pour vous orienter entre les répliques historiques, les versions de pratique et les pièces décoratives, il convient de connaître les variantes classiques et modernes.
| Type | Longueur lame (approx.) | Longueur manche (approx.) | Utilisation |
|---|---|---|---|
| Ō-naginata | 50–60 cm | 180–240 cm | Utilisée en formations et pour les coups à longue portée ; lourde et puissante. |
| Ko-naginata | 30–45 cm | 120–160 cm | Plus légère et maniable ; adaptée aux espaces réduits et à l’utilisation par les femmes. |
| Naginata de pratique | Lame en bambou ou synthétique | Adaptée aux mesures standard d’entraînement | Pour Atarashii Naginata ; sécurité et durabilité. |
- Ō-naginata
-
- Lame : 50–60 cm
- Manche : 180–240 cm
- Fonction : Combat en terrain découvert.
- Ko-naginata
-
- Lame : 30–45 cm
- Manche : 120–160 cm
- Fonction : Défense personnelle et entraînement domestique.
Pratique contemporaine et bienfaits physiques et mentaux
La pratique de la naginata aujourd’hui combine technique, discipline et exercice. Au niveau physique, elle améliore la coordination, la stabilité de la hanche, la force du tronc et la mobilité des épaules. Au niveau mental, elle favorise la concentration, le calme sous pression et le respect de la tradition.
S’entraîner à la naginata implique d’apprendre les déplacements, les coupes contrôlées, les changements de prise et les techniques de défense. L’entraînement met l’accent sur la posture, l’économie de mouvement et le contrôle de l’espace, des compétences transférables à d’autres budō et sports.
Comment identifier les répliques et les modèles (sans conseiller l’achat)
Lors de l’inspection d’une naginata — qu’elle soit historique, réplique ou de pratique — il y a des caractéristiques qui indiquent sa fonction et sa qualité :
- Matériau du bo : Le chêne traditionnel est dense et résistant ; dans les pièces modernes, on utilise des bois laminés ou des matériaux composites.
- Fixation de la lame (nakago) : Dans les répliques historiques, la soie est rivetée ; dans les pièces décoratives, la lame peut être fixée avec des adhésifs.
- Finition de la lame : Les lames authentiques ont une courbure forgée et une finition différenciable ; les reproductions décoratives montrent souvent des soudures ou un profil moins marqué.
- Proportions : Une naginata de pratique a des mesures standardisées ; une pièce historique peut présenter des proportions inhabituelles selon son époque.
Conserver et exposer une naginata

Exposer une naginata demande de l’attention : humidité contrôlée, support qui distribue le poids et éviter les contacts avec des surfaces qui pourraient déformer le manche. Pour les pièces à lame métallique, un nettoyage léger et une protection contre l’oxydation sont conseillés ; pour les manches en bois, un contrôle des insectes et des fissures.
- Évitez : De placer la naginata appuyée sur une extrémité sans support intermédiaire.
- Préférez : Les montages horizontaux avec des fixations rembourrées ou des supports verticaux qui distribuent la charge.
La naginata dans la culture et l’imaginaire
La naginata traverse la littérature, l’art ukiyo-e et la culture populaire comme symbole de résistance féminine et de maîtrise martiale. Cette présence culturelle a contribué à maintenir la curiosité pour l’arme et à soutenir la pratique dans différents contextes : didactique, compétitif et récréatif.
Répliques et modèles disponibles
Si vous souhaitez comparer des modèles et des répliques, n’oubliez pas de distinguer entre les pièces de pratique (bambou ou fibre), les répliques historiques et les objets décoratifs. Chaque catégorie répond à des critères distincts : sécurité, fidélité historique et apparence esthétique.
Ressources pour approfondir
Pour ceux qui souhaitent approfondir la technique ou l’histoire, il convient de rechercher des écoles locales d’Atarashii Naginata, des fédérations nationales et internationales, et de la bibliographie sur le naginatajutsu et l’armement japonais. Participer à un dōjō permet d’expérimenter la différence entre la théorie historique et la pratique moderne.
Mots finaux qui résonnent
La naginata est un artefact à double vie : elle fut une arme de guerre capable de changer le cours d’une bataille et, plus tard, un étendard de discipline et d’autonomisation. Sa transformation — de lame courbe au fil de l’histoire à discipline de vestibule dans les dōjōs modernes — est un témoignage de l’adaptabilité des traditions martiales. La prochaine fois que vous verrez la silhouette d’une naginata, rappelez-vous qu’elle porte des siècles de technique, des noms de guerrières et la volonté de transformer la dextérité en culture.